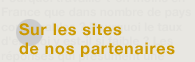Trois leçons sur la société post-industrielle
La société industrielle liait un mode de production et un mode de protection. Elle scellait ainsi l’unité de la question économique et de la question sociale. La « société post-industrielle », elle, consacre leur séparation et marque l’aube d’une ère nouvelle.
Introduction
Marx pensait que l’histoire suivait des phases, et que le capitalisme n’en était qu’une étape. On découvre aujourd’hui que le capitalisme a lui-même une histoire, qu’il ne s’incarne pas au XXe siècle comme au XIXe, qu’il n’est pas semblable aujourd’hui à ce qu’il était hier.
Le capitalisme du XXe siècle s’est construit autour d’une figure centrale : celle de la grande firme industrielle. Celle-ci instaure entre ses membres ce que Durkheim aurait pu appeler une solidarité mécanique. Les ingénieurs réfléchissent à la manière de rendre productifs les ouvriers sans qualification. Les dirigeants sont eux-mêmes salariés, et leurs objectifs rejoignent ceux de leurs subordonnés : protéger la firme des aléas de la conjoncture. De grands conglomérats sont constitués, qui réduisent les risques industriels ; ainsi, de manière à se prémunir contre d’éventuels retournements de la conjoncture climatique, une firme qui fabrique des maillots de bains cherchera par exemple à acquérir une entreprise de parapluies : ainsi, quelle que soit la météo, ses ouvriers auront un emploi. A l’image de la société féodale, la société industrielle du XXe siècle lie un mode de production et un mode de protection. Elle scelle l’unité de la question économique et de la question sociale.
Le capitalisme du XXIe siècle organise scientifiquement la destruction de cette société industrielle. Les différents étages de la grande entreprise industrielle sont dissociés les uns des autres. On recourt aux sous-traitants pour les tâches réputées inessentielles. On regroupe les ingénieurs dans des bureaux d’études indépendants, où ils ne rencontrent plus guère les ouvriers. Les employés chargés du nettoyage, des cantines, du gardiennage sont, chacun, recrutés par des entreprises spécialisées.
La révolution financière des années 1980 change les principes d’organisation des firmes. Un actionnaire n’a nullement besoin qu’une même entreprise fabrique à la fois des maillots de bain et des parapluies. Il lui suffit, pour diversifier son risque, de détenir une action de l’une et de l’autre. Dans un renversement copernicien des fondements mêmes du salariat, ce sont désormais les salariés qui subissent les risques, et les actionnaires qui s’en protègent. C’est la fin de la solidarité qui était inscrite au cœur de la firme industrielle.
La société de services
Parler de société post-industrielle pour caractériser ces transformations est en partie lâche. On désigne en effet le monde par ce qu’il n’est plus, non par ce qu’il est devenu. Pour définir directement la transformation actuelle, plusieurs possibilités sont ouvertes.
On peut tout d’abord parler du passage à une société de services, suivant en cela la classification primaire-secondaire-tertiaire. Jean Fourastié, dès 1949, annonçait comme « le grand espoir du XXe siècle » la venue d’un monde nouveau où l’homme serait enfin libéré de travailler la terre, dans les sociétés rurales, ou la matière dans les sociétés industrielles [1]. Avec l’avènement d’une société de services, la matière travaillée par l’homme est l’homme lui-même. Coiffeur ou docteur, le travailleur renoue un contact direct les humains. Les économistes anglo-saxons ont forgé un terme fidèle à l’idée de Fourastié : le « Face to Face » (ou « F2F »), travail qui exige un contact direct entre le producteur et son client.
Beaucoup d’eau a passé sous les ponts depuis la publication de l’ouvrage de Jean Fourastié. D’un strict point de vue comptable, il ne fait aucun doute que l’emploi est passé de l’industrie aux services, tout comme un siècle plus tôt, il s’était déversé de l’agriculture dans l’industrie. En octobre 2005, le journal anglais The Economist publiait un article indiquant que la part des emplois industriels aux Etats-Unis était descendue en deçà des 10%. Poussant, comme à son habitude, le paradoxe le plus loin possible, l’hebdomadaire ajoutait que ce chiffre, pourtant bas, surestimait en fait la réalité. Au sein du secteur industriel, les tâches de conception et de commercialisation prennent en effet une place croissante. L’industrie elle-même se tertiarise. Le nombre d’ouvriers accomplissant des tâches strictement industrielles, celles qui consistent à fabriquer de ses mains ou à l’aide d’un robot un produit « manufacturier », pourrait être inférieur de moitié au chiffre annoncé, et tendrait ainsi à rejoindre bientôt celui des paysans...
Un malentendu doit être levé pourtant. L’économie tertiarisée n’est nullement « débarrassée » du monde des objets. Ils coûtent certes moins à fabriquer, la part de la production se réduit en valeur, mais ils continuent de croître en « volume », aux mêmes rythmes qu’avant. Les objets sont aussi encombrants que par le passé. Il faut continuer de les déplacer, de les réparer. En toute hypothèse, le grand espoir d’un travail libéré de la dureté liée au monde physique des objets n’est certainement pas advenu, comme en témoigne la hausse régulière des salariés qui souffrent de douleurs physiques et se plaignent de déplacer des objets lourds [2].
Au sein de ce monde tertiarisé, les ouvriers d’usine sont toutefois devenus minoritaires. Les ouvriers sont désormais plutôt manutentionnaires ou réparateurs. Ils travaillent majoritairement dans un environnement de type artisanal plutôt qu’industriel. Les employés forment également une catégorie en pleine mutation. Il y a vingt ans la plus grande partie des employés occupaient des emplois administratifs en entreprise ou dans le secteur public. Aujourd’hui, la majorité d’entre eux travaille dans le commerce ou dans les services aux particuliers. Le client devient une figure centrale de leur existence et passe, à leurs yeux, pour le véritable donneur d’ordres, davantage parfois que le patron lui-même [3].
La société de l’information
Cette première façon d’analyser la sortie de la société industrielle n’épuise pourtant pas la question, même au sens strict d’une définition des métiers qui sont offerts. Les chercheurs qui étudient des bactéries ou améliorent l’efficacité des micro-processeurs sont également de plain pied dans la société post-industrielle. Ces emplois entrent en partie dans la définition donnée par Daniel Bell [4], qui présentait la société post-industrielle comme une société de la connaissance. On dirait plutôt aujourd’hui qu’elle est une société de l’information. Comment la caractériser ?
Un terme a émergé dans les années 1990, qui en éclaire les enjeux : celui de « nouvelle économie ». Celle-ci désigne une modification radicale du paradigme habituel de l’économie, telle qu’elle a été analysée par Adam Smith ou Karl Marx. Adam Smith explique que s’il faut deux fois plus de temps pour chasser un daim qu’il n’en faut pour chasser un castor, le premier animal coûtera nécessairement, en moyenne, deux fois plus cher que le second. La « nouvelle économie » se caractérise par une structure de coût totalement atypique par rapport à ce schéma. Un logiciel coûte cher à concevoir, mais pas à fabriquer. Dans la « nouvelle économie », c’est la première unité du bien fabriqué qui est onéreuse, la seconde et celles qui suivent ayant un coût faible, voire véritablement nul dans certains cas limites. Dans le langage de Smith, il faudrait dire que c’est le temps passé à tuer le premier castor ou le premier daim, c’est-à-dire par exemple le temps passé à découvrir où ils se terrent, qui expliquerait tous les coûts. Et dans le langage de Marx, il faudrait dire que la source de la plus-value n’est plus dans le travail consacré à produire le bien mais dans celui passé à le concevoir.
Un exemple typique est celui des médicaments. Le plus difficile est de découvrir la molécule. Le coût de fabrication du médicament lui-même, que l’on mesure par le prix des médicaments génériques, est beaucoup plus faible que l’amortissement des dépenses de recherche et développement qui est facturé dans les médicaments sous licence. Beaucoup d’autres exemples entrent dans ce cadre. Lorsqu’on produit un film, le coût est dans le tournage ou le montage, plus que dans la fabrication du « négatif ». Plus généralement, l’information, qu’elle prenne la forme d’un code numérique, d’un symbole ou d’une molécule, coûte beaucoup plus cher à concevoir que le contenu physique qui lui est ensuite donné.
Ce paradigme intéresse aussi les firmes industrielles. Ainsi, dans sa campagne de publicité, Renault, symbole hier de la société industrielle, veut se présenter comme « concepteur » d’automobile. Et de fait cette firme tend à fabriquer une part de plus en plus faible des voitures qui portent sa marque. Dans les années cinquante, Renault fabriquait 80% de la voiture qui était livrée au concessionnaire. Aujourd’hui elle n’en fabrique plus que 20%, et déjà le technopole de Renault, à Guyancourt, est le plus grand site « industriel » de la firme, son but étant précisément de fabriquer la première unité... A en croire une anecdote représentative de cette évolution, le chef des achats de Volkswagen au Brésil se serait félicité que son entreprise soit parvenue à externaliser l’essentiel de la fabrication, laissant à la firme allemande ce qu’elle sait faire de mieux : mettre le sigle VW à l’avant de la voiture.
Cette seconde façon de caractériser la société post-industrielle illustre d’une autre manière les causes de la décomposition de la firme industrielle. A l’heure de la mondialisation, les firmes cherchent à se recentrer sur les activités à rayon planétaire, celles qui touchent le plus grand nombre de clients. Les activités immatérielles, où le coût est dans la première unité, la promotion de la marque par exemple, sont beaucoup plus intéressantes que la stricte fabrication des biens qui en découlent.
La « société » post-industrielle
La société post-industrielle fixe ainsi l’unité de deux termes en partie opposés : celui qui correspond à la conception des biens (l’immatériel) et celui qui tient à leur prescription (leur commercialisation). La formule chimique que contient un médicament est immatérielle. Le médecin qui met son oreille sur la poitrine du patient et prescrit le bon médicament est dans le domaine du F2F. Dans les deux cas, c’est la fabrication des biens, comme figure socialement pertinente, qui tend à disparaître.
Ces évolutions semblent rendre naturel le déclin de la société industrielle d’hier. Sur la base de ces mêmes transformations, d’autres évolutions eussent pourtant été possibles, qui auraient pu parfaitement renforcer le modèle antérieur au lieu de le détruire. On aurait ainsi pu imaginer que chaque secteur s’organise autour de quelques grandes firmes industrielles contrôlant l’ensemble de la chaîne de production, en amont dans ses laboratoires de recherche, en aval dans ses réseaux de distribution, internalisant, comme disent les économistes, les activités de conception, de fabrication et de prescription. Telle est d’ailleurs la façon dont on se représentait dans les années 1960 les tendances « spontanées » de l’économie, lorsque Galbraith, par exemple, parlait de « nouvel état industriel ».
Saisir la nature de la société post-industrielle exige donc de faire l’inventaire d’autres ruptures, et de revenir notamment sur les raisons de l’essoufflement de la société industrielle elle-même. Tel sera le thème de la première leçon. Il faudra ensuite découvrir la manière dont la mondialisation, nouvel élément crucial du dossier, contribue à en modifier les formes : ce sera le thème de la seconde leçon. Il faudra enfin saisir les raisons pour lesquelles la régulation de la société post-industrielle semble aujourd’hui si difficile. Ce sera l’objet de la troisième leçon. L’un des paradoxes centraux de notre période, c’est qu’au moment même où la mondialisation ouvre les frontières et confronte presque tous les pays à des défis communs, les modèles sociaux des uns et des autres tendent à s’éloigner. Au sein même de l’Europe, région du monde pourtant très homogène du point de vue économique et institutionnel, rien ne semble plus distincts que les modèles (si ce terme a encore un sens) anglais, scandinave, allemand, ou italien. On a beau parler à tour de bras du modèle français, plus personne ne sait vraiment ce qu’il signifie.
En somme, s’il était facile de parler de « société » industrielle, il est beaucoup plus difficile de parler de « société » post-industrielle. Car, si tout le monde voit aujourd’hui les mêmes films, chacun le fait en étant installé dans des fauteuils de plus en plus différents. Jamais la conscience de vivre dans le même monde n’a été aussi vive. Jamais les conditions sociales d’existence n’ont été aussi distinctes. A l’image des jeux vidéo qui rendent difficile aux enfants de fréquenter ensuite le monde réel, la société post-industrielle creuse l’écart entre l’imaginaire et le réel [5]. La société de l’information accélère la production d’imaginaires technologiques ou consuméristes partagés, la société de services segmente la vie sociale en tranches séparées. En termes lacaniens, on pourrait dire que c’est la fonction symbolique, médiatrice de l’imaginaire et du réel, qui est désormais asséchée.
Durkheim expliquait que la solidarité mécanique entre les membres d’une société pré-industrielle faisait place à une solidarité organique entre les membres d’une société régie par la division du travail social. Celle-ci fait naître, selon lui, un système de « droits et de devoirs qui lient [les hommes] entre eux d’une manière durable » [6]. Dans le monde où nous entrons, on chercherait en vain la solidarité organique que Durkheim appelait de ses vœux. La fin de la solidarité qui était inscrite au cœur du monde industriel laisse totalement ouverte la manière de concevoir la « société » post-industrielle dont on ne mettra plus entre guillemets le premier terme, mais qui fait pourtant partie du problème à résoudre.
Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, La République des idées / Seuil, 2006, ISBN 2.02.085170.9, 10,50 €
Notes
[1] Jean Fourastié, Le grand espoir du XXe siècle, Paris, PUF, 1949.
[2] hilippe Askenazy, Les Désordres du travail, Paris, La République des idées/Seuil, 2004
[3] Eric Maurin, L’Egalité des possibles, Paris, La République des idées/Seuil, 2002.
[4] Daniel Bell, The Coming of the Post-Industrial Society, New York, Harper, 1973.
[5] Voir sur ce point l’article éclairant d’Olivier Mongin, « Puissance du virtuel, déchaînements des possibles et dévalorisation du monde. Retour sur des remarques de Jean-Toussaint Desanti », Esprit, août 2004.
[6] Emile Durkheim, La division du travail social, réédition Presses Universitaires de France, Paris, collection Quadrige, 1991.

 Mots-clés :
Mots-clés :