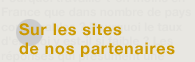Notre première mondialisation
La mondialisation est-elle irréversible ? Non, répond Suzanne Berger, et il suffit d’en faire l’histoire pour s’en persuader. Une histoire qui ne commence pas à la fin du xxe siècle, mais à la fin du xixe, vers 1880, et se fracasse sur la Première Guerre mondiale en 1914. Il faudra attendre 70 ans pour retrouver le même niveau d’investissements à l’étranger, la même fluidité de circulation des biens et des personnes. Les années 1980 : tout recommence. Différemment certes, mais les questions, les enthousiasmes et les peurs se répondent étrangement : " notre mondialisation " résonne comme un écho de la première. Dans un essai construit comme une série d’allers-retours, Suzanne Berger sonde les leçons d’un échec oublié, qui désenchantent notre modernité autant qu’elles en mesurent le prix. Et si la mondialisation, loin d’incarner notre destin, se retirait à nouveau de la scène de l’histoire ?
Depuis la fin de la guerre froide, la mondialisation est devenue l’horizon de nos attentes et de nos peurs. Nous nous considérions jusqu’ici comme les citoyens de nations dont les frontières politiques protégeaient à la fois le pacte social et l’économie. Nous nous voyons à présent comme des individus dans un espace où les biens, les services et l’argent circulent librement, les barrières dressées par les hommes ne leur faisant apparemment plus obstacle. De toutes parts, on annonce l’avènement d’une ère nouvelle dans l’histoire de l’humanité. Beaucoup d’entre nous s’en inquiètent, comme le montre la montée en puissance des mouvements antimondialisation.
Les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale permettent d’appréhender cette nouvelle donne sous un angle différent : d’autres hommes, avant nous, ont dû vivre et comprendre les défis lancés à la démocratie et au progrès social par l’ouverture à l’économie internationale. En revenant sur les débats politiques et les luttes économiques et sociales des pays de l’économie nord-atlantique entre 1870 et 1914, cet essai tente d’élargir la gamme des interprétations à partir desquelles nous décrivons notre propre situation. Il entend par là même réfuter l’idée selon laquelle nous serions sur le point d’entrer dans un monde radicalement nouveau.
Notre attention se portera principalement sur l’expérience française. Au cours des quarante ans qui ont précédé la Grande Guerre, la France était, après la Grande-Bretagne, le pays le plus largement engagé dans l’économie mondiale. Mais à la différence des Britanniques, les Français n’investissaient qu’une très faible part de leurs capitaux dans leurs colonies ; l’essentiel de leurs investissements se dirigeait comme aujourd’hui vers des pays indépendants comme la Russie, la Turquie ou l’Argentine. Autre différence notable et qui renforce la parenté avec notre situation actuelle : les flux migratoires ne jouèrent pas en France un rôle moteur dans le développement de l’intégration internationale.
Car il y a bien parenté : voici cent ans, les pays développés d’Europe occidentale et d’Amérique étaient engagés dans un processus de mondialisation analogue à celui que nous connaissons aujourd’hui. Par mondialisation, j’entends une série de mutations dans l’économie internationale qui tendent à créer un seul marché mondial pour les biens et les services, le travail et le capital. De ce point de vue, la période qui s’étend des années 1870 à la Grande Guerre est bien celle de la " première mondialisation " : l’internationalisation de l’économie y atteignit, dans les domaines du commerce et de la mobilité des capitaux, un niveau qu’elle ne retrouverait qu’au milieu des années 1980. La baisse du coût des transports favorisa un vaste mouvement de populations hors des économies à bas salaires. Des pays comme l’Irlande et la Suède perdirent au moins 10 % de leur population par décennie avant la guerre [1]. Quelque 55 millions d’Européens s’installèrent dans le Nouveau Monde. En Europe occidentale, les travailleurs pouvaient franchir les frontières sans qu’on leur demande ni passeport, ni permis de séjour ou de travail. Rhétorique politique et nouvelles législations sur les tarifs douaniers n’empêchèrent pas les importations et les exportations d’augmenter : en 1910, le commerce extérieur représentait une part des économies nationales qu’il ne retrouverait, là encore, que soixante-dix ans plus tard [2].
Des torrents d’actions et d’investissements directs furent déversés des pays développés vers le Nouveau Monde et vers les pays en voie de développement, aux marges de l’Europe et de l’Asie. Certaines années, la Grande-Bretagne exporta jusqu’à 9 % de son Pib en capitaux, tandis que d’autres pays européens s’approchèrent de ce chiffre [3]. De 1887 à 1913, le volume net des investissements français à l’étranger représentait environ 3,5 % du revenu national - une proportion plus importante qu’aujourd’hui [4]. Les Français envoyaient leur épargne partout dans le monde, et particulièrement en Russie, dans l’Empire ottoman et en Amérique latine. Et déjà les industriels français délocalisaient la production pour s’implanter en Europe de l’Est, en Asie mineure et ailleurs.
En termes de mobilité et d’intégration internationale, nous avons rejoint le niveau de la première mondialisation : la plupart des économistes s’accordent sur ce point, même s’ils divergent sur la chronologie. À l’exception des flux migratoires, nous avons aujourd’hui rattrapé et dépassé les chiffres de la période 1870-1914, après une parenthèse de soixante-dix ans durant laquelle le commerce, les migrations et les flux de capitaux furent sévèrement réduits et contrôlés.
Le but de cet essai est d’étudier les analyses et les réactions de nos arrière-grands-parents aux contraintes, aux pressions et aux choix auxquels nous avons coutume d’identifier la mondialisation. Parce qu’elles constituent la seule expérience historique de démocratie libérale au sein d’une économie ouverte, les quarante années qui ont précédé la Première Guerre mondiale sont un laboratoire de réflexion sur nos propres interrogations. Nous devrions pouvoir y observer les tensions politiques qui affectent la démocratie dans une société sans frontières. Nous devrions pouvoir distinguer les gagnants et les perdants de la mondialisation, suivre les stratégies des forts pour accroître leur avance et celles des faibles pour se protéger des évolutions qui mettent à mal les structures économiques nationales. Nous devrions enfin pouvoir examiner le destin des réformes sociales nationales dans un monde voué à la mobilité des ressources.
Notes
[1] Timothy J. Hatton et Jeffrey G. Williamson, The Age of Mass Migration, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 3-7.
[2] Richard E. Baldwin et Philippe Martin, "Two Waves of Globalization : Superficial Similarities, Fundamental Differences", H. Siebert (ed.), Globalization and Labor, Tübingen, Mohr Siebeck, 1999, p. 29.
[3] Michael Bordo, Barry Eichengreen, Douglas Irwin, "Is Globalization Today Really Different than Globalization a Hundred Years Ago ?", Nber, 1999, p. 28.
[4] Maurice Lévy-Leboyer et François Bourguignon, L’Économie française au XIXe siècle, Paris, Economica, 1985, p. 232-233.

 Mots-clés :
Mots-clés :