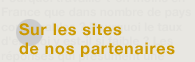Demandes de sécurité
La délinquance s’est installée, non sans raison, au cœur du débat politique. Mais les explications morales ou culturelles (« crise des valeurs », « effondrement de l’autorité », etc.) semblent avoir congédié les leçons de l’analyse sociale. Pourtant l’évolution de la pauvreté dans les pays riches, le manque de mobilité sociale et économique des plus démunis ou les carences de formation pèsent plus que jamais sur les mutations de la délinquance. Hugues Lagrange propose, pour le montrer, d’élargir l’enquête à l’ensemble des démocraties occidentales. Car celles-ci sont secouées par une même lame de fond : l’affirmation d’une délinquance plus violente, plus jeune et plus étroitement liée aux trafics de drogue. Ce phénomène suscite des réactions variables : les taux de détention sont d’autant plus élevés et le recours à la responsabilité individuelle plus fréquent que l’État social est traditionnellement faible. Si les Européens veulent résister à la tentation carcérale et mener des politiques de réduction durable de la délinquance, ils ne doivent pas seulement garantir l’ordre public à court terme, mais aussi renouveler leurs stratégies d’intervention sociale. C’est la leçon de cet essai qui brasse un grand nombre de données et d’études peu connues en France.
Comment renouer avec une compréhension sociale de la délinquance alors que dominent des lectures morales qui en rabattent immédiatement les enjeux sur la « crise des valeurs » ou l’« effondrement de l’autorité » ? Partir à la recherche des ressorts sociaux et des responsabilités collectives en matière de déviance aujourd’hui, n’est-ce pas faire preuve de « naïveté » ? La politique de sécurité mise en œuvre en France depuis quelques mois se passe, semble-t-il, fort bien des leçons de sociologie sur le sujet. En réarmant l’autorité d’un État répressif sans lequel, disons-le, les conditions élémentaires d’une lutte efficace contre les violences ne seraient pas réunies, elle donne voix et corps à la demande populaire qui s’est exprimée dans les urnes au printemps 2002, demande remontée de toutes parts et notamment des quartiers de relégation où vivent ceux que l’on a justement nommés les « oubliés ».
Mais cette politique suffira-t-elle ? Est-elle en mesure de comprendre - et donc de combattre - l’intégralité du problème auquel elle vient de déclarer la guerre ? Ce n’est pas sûr. Les « oubliés » ne sont pas seulement les victimes : ils forment en même temps le bassin de recrutement de la grande majorité des auteurs d’infractions. Il ne s’agit pas, en disant cela, de minorer les « effets apparents » au profit de « causes profondes » qui seraient seules dignes d’intérêt : la violence n’est pas seulement un symptôme, elle développe également ses propres processus de socialisation et de perpétuation. Il s’agit plutôt de se demander si le cadre de la réflexion ne mérite pas d’être élargi. Si, dans le temps même où, l’œil rivé sur le compteur statistique, on déploie des efforts de contrôle policier et judiciaire inédits, il ne conviendrait pas de considérer des facteurs aussi massifs que l’évolution et la concentration de la pauvreté ou du chômage dans les strates les plus fragiles de la population. Si, dans le temps même où l’on procède au renforcement de l’État pénal, il ne serait pas tout aussi légitime de repenser les formes d’intervention de l’État social.
Le cadre national de la réflexion sur la délinquance est-il lui-même encore le plus pertinent ? La France n’est pas une île au milieu du monde. Son espace domestique est quotidiennement traversé par des flux internationaux de marchandises, de migrations, d’informations, de valeurs, de représentations... Quotidiennement, le lointain fait effraction dans l’intimité de nos sociétés et se mêle à nos réactions, nos opinions, nos choix. De sorte qu’il devient toujours plus indispensable de s’éloigner pour se comprendre, de regarder ailleurs pour se reconnaître, de s’exiler pour se retrouver. La nature et le niveau de la délinquance à laquelle nous devons faire face aujourd’hui n’échappent pas à cette règle. Si l’on veut se les expliquer correctement, il faut les situer dans la longue durée et dans un paysage plus vaste : celui des démocraties occidentales et de leur évolution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est dans les rapprochements avec nos partenaires américains et nos voisins européens qu’apparaissent les lames de fond de cette histoire. Tels sont à la fois l’hypothèse et le pari de cet essai.
Mais, dira-t-on, ce paysage est-il homogène ? Les divergences n’y sont-elles pas plus nombreuses que les convergences ? Ainsi, depuis vingt ans, les États-Unis se sont engagés dans une politique pénale dont l’aspect aujourd’hui le plus saillant est le développement de la prison à une échelle de masse. Avec 2 millions de prisonniers et plus de 5 millions de personnes sous contrôle judiciaire, ils ont instauré un mode de gestion de la société inconnu jusqu’alors dans les démocraties. Parallèlement, ils ont sollicité le marché à travers des dispositifs technologiques, les assurances et pour la construction de bulles de sécurité. Si les dynamiques de la criminalité sont similaires en Europe et aux États-Unis, si en dépit des politiques sociales, une fragmentation de la société produit de part et d’autre de l’Atlantique ce que les Anglo-Saxons appellent une sous-classe pauvre - ce que nous désignons comme des poches de relégation -, la poussée répressive américaine reste sans équivalent et n’a d’ailleurs pas été explicitement revendiquée comme un modèle à suivre par les responsables européens. Toutefois, les politiques carcérales se sont considérablement durcies de ce côté-ci de l’Atlantique depuis une dizaine d’années. Le taux de détention a ainsi augmenté de plus de 50% en Espagne et au Portugal entre 1988 et 1997. La plupart des pays d’Europe de l’Ouest ont vu croître leur population carcérale depuis le début des années 1990 (une croissance de près de 40% au Royaume-Uni entre 1993 et 1999). La France a vu sa population carcérale croître sensiblement de 1975 à 1981 puis de 1986 à 1996, avant de connaître à la fin du siècle une amorce de désinflation. Mais elle risque de connaître à son tour le même mouvement que ses voisins : les mesures prises récemment à l’égard des mineurs et des marginaux substituent à une prise en charge sociale des déviances des dispositions tendant à élever le nombre de conduites passibles d’emprisonnement. Un seul grand État européen échappe au mouvement général de durcissement carcéral : l’Allemagne.
Quelles sont les causes de ce mouvement ? Les politiques publiques se réfèrent moins au niveau de la criminalité qu’à l’appréhension vécue et aux préoccupations dont la délinquance et le crime sont en partie la source. On ne peut comprendre la place centrale qu’occupe désormais ce mot ambigu « d’insécurité », sans prendre en compte l’émergence et le maintien durable sur le sommet de l’agenda politique d’une inquiétude qui prend la démocratie « à la gorge ». Cependant son exacerbation ne doit pas occulter la multiplicité de ses origines. Ainsi, on l’a souvent souligné, la peur suscitée par les attentats du 11 septembre est entrée en résonance avec d’autres préoccupations (tensions intercommunautaires, peur de l’islam...). Mais faut-il ne retenir que cela ? Les tensions qui fragilisent la cohésion sociale de plusieurs pays d’Europe ne sont pas pensables en dehors des changements résultant de l’effondrement du communisme et de la radicalisation de nouvelles lignes de fracture entre les segments les plus pauvres et les moins diplômés des sociétés riches. Les effets des politiques des grands organismes régulateurs comme le Fonds monétaire international, conjugués avec le recul de l’aide publique au développement, ont été désastreux : les injonctions faites aux pays d’Asie et surtout d’Afrique d’ouvrir leurs frontières ont accéléré, sous couvert de liberté des échanges, la déstructuration de leurs économies et suscité des mouvements migratoires importants, engendrant en Europe des flux de population qui ne viennent pas exclusivement des couches les plus pauvres.
Alors, qu’il faille répondre fermement à la recrudescence du banditisme et du crime organisé qui sont à la source de beaucoup de violences, c’est certain. Que le développement de la violence juvénile appelle des réponses déterminées, ne l’est pas moins. Mais cela ne dispense pas pour autant d’une réflexion sur les sources de cette délinquance.
Par le recours massif à la prison et par l’application de la peine de mort, les États-Unis incarnent le visage nocturne de la démocratie. Que s’est-il passé au sein de la « maison commune » des démocraties pour qu’apparaisse un tel visage ? Cette question est centrale. Mais il s’agit aussi de considérer les enjeux européens et français à la lumière transatlantique sans se contenter d’un regard éloigné, car l’expérience américaine recèle un certain nombre d’enseignements utiles à la fois pour comprendre la nature de la délinquance à laquelle nous avons affaire et pour évaluer la pertinence des réponses à y apporter.
Pour le moment, parce qu’elles se refusent à prendre en compte toutes les dimensions du problème, les politiques de sécurité qui se développent dans les démocraties occidentales risquent de rester longtemps hémiplégiques ; pis : de favoriser le développement d’une réponse inadéquate aux difficultés. Faute d’envisager une politique véritablement inclusive, de revendiquer l’intégration de ceux que la compétitivité et le manque de ressources rejettent, elles se rabattent sur le dernier langage disponible à la souffrance et à la peur : le langage pénal. De droite à gauche, à la fin des années 1990, dans ce domaine, les solutions nord-américaines ont été accueillies sans véritable réflexion critique. En fait, cet attrait pour les réponses américaines ne peut être compris en dehors de la délégitimation tacite des politiques d’aide sociale : on pense en effet, sans toujours le dire ouvertement, que ces politiques, mises en œuvre dans de nombreux États européens, sont vouées à l’échec ou largement inadéquates.
Cette critique n’est pas entièrement fausse : les politiques à dominante éducative, tutélaire ou assistancielle adoptées au lendemain de la Guerre connaissent une crise qu’il est inutile de nier. Mais faut-il, parce que ces instruments donnent des signes d’usure ou d’inadaptation, renoncer à toute forme d’action sociale sur ce terrain ? Autrement dit, veut-on vraiment que l’État renonce à la compréhension sociale de la délinquance au bénéfice d’une sollicitude pour les victimes de malveillances ordinaires et d’incivilités [1], et qu’il continue à ignorer les atteintes moins figuratives que le productivisme et la compétition généralisée engendrent ? Et, dans le cas contraire, quels seraient les scénarios disponibles pour échapper à cette dérive ? Faut-il revenir à l’hypothèse désormais très improbable d’un nouveau contrat social entre des « classes » en lutte ? Ou bien imaginer des politiques d’inclusion mieux à même d’activer les capacités instituantes de la société civile et d’inscrire les individus dans des « solidarités flexibles » qui ne les assignent pas nécessairement à des collectifs d’appartenance, mais sécurisent néanmoins leurs parcours et accroissent leur mobilité ? Le contrôle social ne peut se réaliser qu’en produisant simultanément de l’autonomie, une « capacité des acteurs [...] de se prendre en charge [2] ». Si l’Europe veut résister à la tentation carcérale, elle doit faire autre chose que de reconduire des démarches adaptées à la période qui suivit la Seconde Guerre mondiale. Elle pourrait d’ailleurs tirer parti à sa manière de certains des programmes américains les plus prometteurs en matière d’insertion et des idées susceptibles de réorienter l’action sociale vers une plus grande « égalité des possibles [3] ». En tout cas, elle doit aujourd’hui produire des réponses cohérentes dans l’esprit d’une justice sociale reconstructrice.
Hugues Lagrange, Demandes de sécurité, La République des idées/Seuil, 2003, ISBN 2-02-058035-7
Notes
[1] C’est-à-dire d’un ensemble assez hétéroclite d’actes et de conduites incriminables mais rarement poursuivis formellement, comme les dégradations, lacérations, dépôt sauvage d’ordures, bruits intempestifs, bris de boîtes aux lettres, etc., qui ont rendu visible une nouvelle rugosité des mœurs et contribué à aiguiser la sensibilité à la délinquance.
[2] François Dubet, Le Déclin de l’institution, Paris, Seuil, 2002.
[3] Éric Maurin, L’Égalité des possibles, Paris, Le Seuil/La République des Idées, 2002.

 Mots-clés :
Mots-clés :