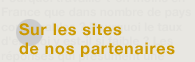L’inflation scolaire
« Les études, plus on fait, mieux on se porte ». Voici ce qu’on pourrait lire dans le Dictionnaire des idées reçues contemporaines à l’entrée « Ecole ». Cette conviction partagée est-elle encore pertinente ? On peut en douter. Pour les individus d’abord, dont le mérite ne se trouve pas nécessairement mieux reconnu, ni l’hérédité sociale mieux conjurée, parce qu’ils seront restés plus longtemps sur les bancs de l’école. Pour la société ensuite, car la distribution des places et des emplois ne se fait pas forcément de manière plus pertinente quand elle s’appuie sur les seuls diplômes délivrés par l’école. Bref, devant les déceptions et les sentiments de déclassement que creuse et creusera davantage encore demain « l’inflation scolaire », le temps est peut-être venu de se défaire d’une idée devenue un dogme et de repenser les manières d’entrer dans la vie.
Introduction
Paradoxalement, alors que l’école est volontiers critiquée, il semble évident pour beaucoup que « toujours plus » d’école constitue un gage de progrès et de justice sociale. Grâce à des études plus longues, des qualifications scolaires plus élevées, une population diplômée plus nombreuse, nous serions individuellement mieux armés pour entrer dans la vie et collectivement mieux préparés à affronter l’avenir. Qui oserait s’élever contre cette conviction serait immédiatement considéré comme rétrograde. C’est pourtant cette conviction que l’on voudrait discuter ici, quitte à bousculer quelques préjugés et à lever certains tabous. En effet, il devient chaque jour plus incertain qu’en persévérant dans la voie de l’inflation scolaire nous prenions le chemin du progrès et de la justice sociale. Au contraire, il est à craindre que cette fuite en avant ne conduise à esquiver la question brûlante des modes d’entrée dans la vie des jeunes d’aujourd’hui et du rôle de l’école en la matière.
Avant d’aller plus loin, il importe de se demander pourquoi la prolongation des études et l’élévation des qualifications scolaires s’imposent comme des politiques consensuelles qui confèrent à l’école et à ses diplômes une emprise toujours plus forte sur les destinées individuelles. Cette emprise est en fait le lot de toutes les sociétés modernes, confrontées à la double tâche d’introduire dans la vie les jeunes générations et de les répartir dans les différentes professions. L’affirmation de l’idéal égalitaire et la complexification de la division du travail ont progressivement rendu intenable une gestion purement privée de ces deux processus, et inacceptables les inégalités qui en découlaient. Pour résoudre la tension entre des individus devenus égaux en droit et des positions sociales de plus en plus diversifiées et inégales, la méritocratie s’est progressivement imposée comme idéologie fondatrice des sociétés démocratiques. L’égalité politique est censée se doubler d’une égalité, non pas dans les positions sociales et les divers avantages qui leur sont attachés, mais dans les chances qu’ont les individus d’y accéder, sur la base de leurs aspirations et de leurs qualités personnelles. La place que l’on occupe in fine dans la division sociale du travail doit dépendre, non plus de facteurs hérités, mais de ressources propres, acquises et mobilisées par l’individu lui-même : le mérite en devient le grand ordonnateur.
C’est l’institution scolaire qui s’est vu allouer la responsabilité de détecter, de cultiver et de sanctionner ce mérite par des diplômes. Il s’agit d’un phénomène relativement récent. Comme l’analyse A. Prost pour la France1, à partir du moment où la Révolution pose le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics, le rôle donné aux diplômes ne va cesser de croître. Avec le développement des connaissances et la sophistication des techniques, leur influence devient décisive après la Seconde Guerre mondiale : l’articulation entre les formations et les emplois se fait de plus en plus étroite et l’accès à l’élite ne se conçoit plus sans diplôme. Cette évolution n’est pas achevée. Le sociologue américain D. Bell soutient que la logique des sociétés post-industrielles, pour s’adapter aux nouvelles exigences de la division du travail, est de tendre vers toujours plus de méritocratie. Car un fonctionnement méritocratique constitue non seulement une façon équitable d’allouer les positions sociales - chacun obtient la place qu’il mérite -, mais aussi la manière la plus efficace de mobiliser la variété des talents individuals : la méritocratie est un principe régulateur qui débouche sur une société modèle où se conjuguent la justice pour les individus et la performance pour la collectivité.
Dès lors, il paraît juste et efficace de renforcer toujours plus l’emprise des diplômes. Personne ne conteste ouvertement, dans notre pays, les politiques scolaires poursuivies depuis la seconde moitié du xxe siècle, qui visent à prolonger les scolarités et à accroître toujours plus le nombre des diplômés. Dans la récente et très discutée « loi Fillon » sur l’Éducation, l’objectif de doter un jeune sur deux d’un diplôme de l’enseignement supérieur est passé sans contestation3... Ce consensus concernant l’allongement des scolarités se comprend aisément4. Pour l’État, il implique évidemment une politique coûteuse. Mais, à court terme, elle écarte du chômage un nombre important de jeunes, ce qui est économiquement et politiquement intéressant. L’incertitude sur l’avenir joue également, et l’État peut juger qu’il est de sa responsabilité d’armer le mieux possible les jeunes générations pour affronter un marché du travail difficile. Les entreprises y trouvent également leur compte : l’abondance de diplômés met à leur disposition une « armée de réserve » qualifiée, facteur de pression sur les salaires, et rassurante dès lors qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait. L’incertitude sur l’évolution du contenu des emplois et des compétences requises pour faire face aux mutations de l’économie amène à regarder d’un bon œil l’élévation du niveau de formation des jeunes, d’autant que les entreprises sont très peu impliquées dans son financement. La crainte d’une surproduction de diplômés inadaptés au monde du travail n’a plus guère cours, même si elle affleure çà et là, quand certains patrons se plaignent de ne pas trouver de main-d’œuvre pour les emplois les moins qualifiés. Les jeunes et leurs familles adhèrent également volontiers à ces politiques : des diplômes de plus en plus élevés leur apparaissent comme une protection, à moyen terme, pour la vie professionnelle qui s’annonce, et évidemment à court terme, pour se placer au mieux dans la file d’attente, d’autant que le chômage est tel que le « coût d’opportunité » des études (ce à quoi on renonce pour les suivre) apparaît peu important. Évidemment, les familles les plus instruites vont défendre, plus encore que les autres, toute politique d’allongement des études, pour que leurs enfants restent en tête. Enfin, les professionnels de l’éducation sont également favorables à la prolongation des études parce qu’elle renforce leur emprise et entretient leur marché du travail, à tel point que l’administration s’inquiète dès que les effectifs des élèves ou des étudiants cessent d’augmenter ; il est vrai que les effectifs et les moyens afférents sont le gage de l’importance sociale de toute corporation... Tous les acteurs en présence ont donc de bonnes raisons de défendre l’expansion continue des scolarités. Naturellement, cette expansion, faut-il le rappeler, n’est qu’un objectif intermédiaire, l’objectif final étant un surcroît d’efficacité économique et de justice sociale.
Tout développement de la scolarisation apparaît donc comme bon, juste, efficace. Tel est aujourd’hui le dogme. Pour les individus, on allège ainsi le poids des déterminismes sociaux ; dans une version généreuse et simpliste, cela donne : puisque l’accès au bac est marqué par une sélection sociale, ouvrons l’accès au bac et il n’y aura plus de sélection sociale... Pour la société aussi, l’allongement des scolarités aurait des effets forcément positifs, notamment sur le plan économique, avec à nouveau des versions généreuses et simplistes telles que : puisque les jeunes sans formation sont les plus touchés par le chômage, réduisons cette population et nous réduirons le chômage...
Tout cela est-il si sûr ? Ces questions, qui font l’objet d’importantes polémiques scientifiques dans certains pays voisins, restent relativement taboues en France où il paraît incongru, voire sacrilège (et politiquement suspect), d’interroger le bien-fondé du développement continu de la scolarisation. Pourtant, puisque c’est là l’objectif final essentiel, des études de plus en plus longues sont-elles la seule manière d’aider les jeunes à entrer dans la vie ?
Pour instruire ces questions, il convient d’explorer sans interdit les effets de l’éducation, à la fois pour les individus (niveau « micro ») et pour la société (niveau « macro »), sachant que les conclusions peuvent diverger selon le niveau considéré : plus d’éducation peut avoir des effets positifs au niveau individuel, en termes de salaire par exemple, sans qu’on enregistre un surcroît de richesse au niveau de la société dans son ensemble.
Nous commencerons donc par décrire le rôle de l’école dans le processus de répartition des individus dans les places inégales de la société : l’école est-elle réellement un « ascenseur social », comme on le dit souvent ? Nous répondrons en adoptant une double perspective : celle, plutôt sociologique, de la mobilité sociale et de l’inégalité des chances devant l’école, et celle, plutôt économique, des relations entre formation et emploi et de la valeur des diplômes. La méritocratie apparaît alors bien imparfaite. Mais on ne saurait s’arrêter à ce constat, somme toute assez classique, sans poser une autre question : la méritocratie elle-même est-elle un gage de justice sociale ? Nous montrerons qu’on ne peut accepter sans réserve le postulat d’équivalence entre titres scolaires et mérite supposé par le modèle méritocratique, pas plus que l’idée selon laquelle la valeur professionnelle résulte des compétences acquises à l’école et de cela seulement. Comment est produit le mérite scolaire ? Recouvre-t-il le « mérite professionnel » ? Ces questions sont cruciales pour évaluer en termes de justice le rôle effectivement rempli par l’école.
Il faut ensuite passer de ce point de vue statique - évaluant le fonctionnement actuel de l’entrée dans la vie et son caractère méritocratique - à un point de vue plus global et dynamique débouchant sur des considérations politiques : quels bénéfices la société tire-t-elle d’une population de plus en plus instruite ? Faut-il continuer à allonger les scolarités ? Il ne s’agit pas de contester une politique qui viserait à donner à tous un niveau d’éducation élevé, ni de recenser une fois de plus tous les effets positifs de l’éducation, mais de s’interroger sur les dérives et les effets pervers possibles d’une expansion de l’éducation qui s’est progressivement focalisée sur des objectifs quantitatifs - x % d’élèves à tel niveau - et des visées économiques. On peut se demander si, alors même que les bénéfices collectifs de cette politique restent incertains, elle ne constitue pas le meilleur moyen d’entretenir les inégalités sociales qu’elle prétend combattre, par les arbitrages qu’elle entraîne pour l’État, et les stratégies qu’elle suscite chez les acteurs. Il faut aussi se demander si elle ne pervertit pas profondément le sens de la formation, en polarisant les gouvernants sur des objectifs quantitatifs, et les élèves sur cela seul qui est utile. On peut se demander, enfin, si elle ne rend pas in fine plus difficile encore l’entrée des jeunes dans la vie, sans pour autant rendre plus juste l’allocation des places qu’ils y occuperont... C’est alors à des modalités alternatives de la sélection scolaire et sociale qu’il convient de réfléchir.

 Mots-clés :
Mots-clés :