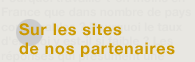La Controverse des sexes
La discussion sur la parité est née, en France, au début des années 1990. Cette discussion venait d’ailleurs, d’un rapport du Conseil de l’Europe, et de la mouvance verte, surtout allemande. L’idée prit très vite forme en raison de la situation française. La France était alors l’avant-dernier pays d’Europe en nombre de femmes élues au Parlement. La comparaison européenne n’était guère flatteuse pour un pays qui est si fier de 1789, de sa Révolution comme de sa Déclaration des droits de l’homme. Une décennie plus tard, nous avons donc changé la Constitution, nous avons une loi pour "favoriser l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions". Nous avons eu un débat public, une "controverse" dans les journaux, les cafés et les cuisines..., et nous sommes toujours, à l’heure actuelle, un des derniers pays d’Europe ! Les faits sont têtus. Et pourtant la parité est désormais un événement politique de notre histoire récente, autant qu’une belle controverse théorique, conceptuelle et pragmatique. Les récentes élections municipales et sénatoriales, qui ont eu lieu depuis le vote de la loi, témoignent d’une évolution, non pas d’une révolution.
En 1949, Simone de Beauvoir avait un a priori, critiqué par elle-même plus tard, celui de se représenter l’histoire du féminisme comme celle d’une querelle, répétée et répétitive. "Quand on se querelle, on ne raisonne pas bien", écrit-elle en ouverture du Deuxième Sexe.
Pourtant la querelle est bien une affaire de raisonnement, de mots et d’arguments, de pensées et de verbes. La querelle n’est pas un soliloque, elle est un échange, elle a un interlocuteur. Donnons donc tort, avec affection, à Simone de Beauvoir. Les femmes, comme les hommes, querellent l’autre sexe ; et le féminisme participe de cette vaste querelle ; et la querelle du féminisme, dont tout le monde connaît si bien la passion, révèle toujours un argumentaire serré. Le féminisme pense.
Dans l’histoire longue de la revendication des femmes, il faut suivre le fil essentiel du principe égalité. L’idée de l’égalité entre les sexes est ancienne mais son efficace historique est variable. Depuis la Renaissance, l’idée d’une commune mesure entre les sexes s’est installée dans la littérature. D’où la querelle à propos du meilleur sexe, la femme ou l’homme, querelle qui ne prend tout son sens que parce qu’ a surgi l’utopie de cette mesure commune qui s’appelle l’égalité. L’égalité, en effet, nécessite un espace homogène où se pense et se rêve une mesure commune aux deux sexes. La querelle à propos de l’excellence de l’homme ou de la femme est comme un rempart contre cette utopie trop forte. Mais elle en est en même temps l’ingrédient principal ; la valeur supposée de l’un ou l’autre sexe alimente le rêve d’un meilleur échange, ou le cauchemar d’une défaite possible ; c’est selon. Pendant ce temps, l’égalité apparaît comme l’impossible.
Cette querelle n’a pas disparu. Le débat sur les valeurs et qualités féminines, en politique ou ailleurs, l’atteste. Mais depuis la Révolution française, l’égalité a troqué son statut d’idée pour celui de principe. Le principe égalité, ici d’égalité des sexes, a créé un espace de revendication qui a permis un affrontement réel autant que des aspirations concrètes. Cet espace est rempli alors par des arguments pour ou contre l’égalité, et la querelle sur les valeurs a cédé la place au procès de l’inégalité, à la critique de la domination masculine. Le procès est la figure rhétorique nouvelle. Ce procès dure encore aujourd’hui dans toutes les formes du combat féministe. Mais la conscience, la connaissance de cette procédure politique reste plutôt faible : certains continuent de nier la domination de l’homme, pourtant universelle ; d’autres ignorent la résistance des femmes, pourtant très ancienne ; les uns et les autres se gardent le plus souvent de théoriser simultanément domination et résistance, bâtissant des analyses unilatérales. Et d’autres encore affirment que le principe égalité fait tout ; et assez. Reste simplement à l’appliquer. Je reviendrai sur cette croyance, naïve, en l’application évidente d’un principe.
La querelle traverse les siècles ; le procès, la procédure démocratique suit son cours ; et nous entrons désormais dans le temps de la controverse. Les arguments s’échangent, et on se dispute autour d’un objectif désormais commun, l’égalité. Il est devenu inimaginable d’affirmer l’inégalité. Qu’importe si certains font semblant, jouent les hypocrites. Il existe désormais un cadre commun où chacun tente d’énoncer le plus juste, le plus égal. On se dispute sur les moyens et non plus sur la fin ; apparemment du moins. Le débat sur la parité de ces dernières années relève de la controverse entre les sexes.
Qui dit controverse dit désaccord. Un des intérêts de la controverse sur la parité fut de s’apercevoir que le débat n’opposait pas simplement les hommes et les femmes, mais les femmes elles-mêmes, entre elles. Evidemment, il y eut, depuis toujours, des femmes exprimant une réticence à l’émancipation, et des hommes prenant le parti du féminisme. Mais dans le débat sur la parité, la controverse s’établit clairement entre les femmes elles-mêmes. Quelques esprits chagrins s’en émurent comme si c’était là un signe de faiblesse aussi bien des femmes que de la cause elle-même. Il en va, à mes yeux, tout autrement. Le désaccord montrait à l’évidence que les femmes étaient suffisamment nombreuses pour que leurs voix soient multiples et diverses. Le temps de l’héroïne, de la porte parole, de l’exception singulière est donc bien passé. De nombreuses femmes aujourd’hui ont accès à la publicité de la pensée qui va de pair avec l’exercice démocratique. Ainsi, le désaccord m’a paru bon signe : nous étions assez nombreuses pour n’être pas d’accord. L’espace public, journaux et livres, en se faisant l’écho de la controverse, accréditait un peu plus la pénétration des femmes dans la fabrique de l’histoire. De là à ce que les femmes soient vues comme partie prenante du débat sur les "intellectuels", à nouveau très vif en France, est un pas qui n’est pas encore franchi. La fragilité de l’existence publique des femmes est encore la règle.
Le premier cercle de la controverse : naturalité et universalité
Les repères conceptuels du débat politique sont brouillés dès qu’on parle des femmes. C’est pourquoi il faut être heureux de voir la controverse s’installer pour de bon. En effet, les formes récentes de la controverse montrent à quel point le problème de l’égalité entre les sexes reste peu élaboré. Sur deux registres d’arguments, une naïveté anachronique fait obstacle. Il s’agit de la naturalité du progrès et de la sûreté de l’universel.
Avant même de discuter le sens de la parité, l’idée qu’une loi puisse intervenir dans notre société pour corriger l’inégalité entre hommes et femmes peut scandaliser. Pourquoi une loi, ont dit certains, convaincus que l’histoire montrait un progrès continu, accumulait pas à pas, bref tendait inéluctablement à réduire les inégalités. Pour un peu, d’aucuns auraient pu dire que l’histoire, depuis qu’elle s’écrit avec la démocratie, accompagne inéluctablement le développement de l’égalité entre les sexes. Que soit alors oubliée la réticence des premiers démocrates, après la Révolution, à accorder aux femmes le "droit de cité", et bien d’autres droits, que soit méconnue, les discriminations économiques actuelles ou le renouvellement permanent de l’exploitation sexuelle des femmes importe peu ici. La croyance à l’évidence d’un progrès spontané et continu défie toute observation réaliste. Mais cette conviction d’une naturalité du progrès de l’égalité des sexes a un corollaire tout aussi étonnant, à savoir la réticence à vouloir une loi pour fabriquer de l’égalité. C’est comme si la question des sexes échappait à une règle simple et bien connue, règle qui nous dit que personne n’a jamais produit de l’égalité sans contrainte. L’égalité n’est jamais spontanée, première ; elle est toujours produite. Et le meilleur exemple de cette règle est l’enseignement obligatoire, créé en France il y a plus de cent ans par une loi qui fut, pour bien des parents et des enfants, une contrainte. Et pourtant, personne ne devrait être hostile à l’école, à l’accès au savoir, à la connaissance...La controverse se construit donc sur une base étonnamment primitive : une loi pour la parité serait une violence au mouvement naturel de la démocratie !
À ce registre naturaliste de la croyance au progrès spontané, se joint le registre de l’autorité politique : l’universalisme ne se discute pas ; l’universel est neutre, et tout est dit. Et si certains, percevant l’écart entre le dire et le faire, envisage une loi correctrice (la parité), on crie au danger ; la bonne santé de l’universel est menacée. Qui songe pourtant sérieusement à détruire le référent universel ? Qui plaide en France pour la décomposition de l’universel ? Personne, me semble-t-il. Et pourtant, comme en miroir de la croyance au progrès continu et sûr de l’égalité démocratique des sexes, on invoqua le danger encouru par l’universalisme qui changerait d’image s’il devenait concret. En clair, son efficacité diminuerait à être renvoyée à la réalité de ses expressions singulières ; cependant que la réalité de son histoire témoignait de son disfonctionnement : tout le monde sait que l’universel, depuis deux siècles, ment, notamment avec l’expression "suffrage universel" qui, de 1848 à 1944, pendant près d’un siècle, a désigné le suffrage masculin. Son efficacité serait-elle annulée si on sortait du mode incantatoire de l’application des grands principes pour trouver des solutions réelles à la discordance entre le principe et la réalité ? Et pourquoi toute tentative de résoudre la discordance entre l’universel et la discrimination évoque-t-elle toujours la revendication catégorielle, donc un supposé triomphe du particulier contre l’universel ? L’anathème de "repli identitaire" empêche de voir que la demande des femmes est d’habiter l’universel plutôt que de le morceler, d’oeuvrer au "déploiement identitaire" avec autrui.
Egalité et universalité : voilà deux bons vieux mots de la politique démocratique nécessaires à la fabrication de l’histoire des sexes, à qui on propose cependant de surplomber cette histoire. Dans un premier cercle d’arguments, la controverse est très curieusement animée par des arguments qui se servent de la théorie classique de la science politique sans utiliser l’expérience historique de ces concepts, expérience de la difficulté, pour la démocratie, à construire l’égalité et à respecter l’universel. Ces deux concepts semblent, ici, curieusement vierges de toutes les critiques accumulées par l’histoire du XIXème et du XXème siècle. On remarque, une fois de plus, combien l’historicité de la différence des sexes est problématique.
L’opinion est plus forte que l’histoire
Trois opinions font donc obstacle à la pensée de la politique des sexes : celle qui nie l’inégalité entre hommes et femmes et tourne le dos au réel (seuls les chiffres et les statistiques font preuve face à ce déni) ; celle qui affirme le mouvement inéluctable et tranquille de l’égalité, et refuse que la relation des sexes implique un rapport de force politique ; celle qui campe sur le sommet des grands principes et masque la collusion, pourtant bien connue, entre universel et domination. Alors l’histoire des sexes doit partir de ces trois éléments : la réalité tangible de l’inégalité, l’existence d’un rapport de force et d’une résistance de part et d’autre des sexes, la vérité de la domination masculine. Curieusement les protagonistes de la controverse ne conjuguent pas toujours ces trois éléments ensemble. Et parce qu’ils les isolent, ils alimentent la controverse sans pouvoir faire histoire.
Le deuxième cercle de la controverse : le principe, le concept, et l’outil
Le premier cercle de la controverse paraît comme un en deça de la politique fondamentale par sa croyance naïve au progrès et sa confiance aveugle en l’universel sous sa forme déclarative, le second cercle, en revanche, nous entraîne vers des considérations moins classiques.
Maintenant, nous pouvons commenter l’introduction du mot de parité. "Le débat sur la parité", lancé au début des années 9O, a clairement désigné son objet, l’absence des femmes dans la représentation politique. Il a, ensuite, cristallisé l’ensemble du renouveau féministe. Deux remarques, alors, sur la nécessité d’un mot neuf pour parler d’égalité des sexes. La première pour souligner l’étape ultime du combat pour l’égalité des sexes, le partage du pouvoir, en langage européen, "la prise de décision". Après deux siècles de batailles pour les droits civils et politiques, pour les droits de l’individu à disposer de son corps, à apprendre et à travailler, le temps est venu de prendre part aux affaires de la cité à son plus haut niveau. La parité est, donc, l’expression de l’affaire ultime de l’égalité, celle du pouvoir.
_ La seconde remarque est sur le mot lui-même,et son efficace sémantique et politique : le mot "parité" a permis d’esquiver le mot de féminisme qui toujours en France est un mot malpoli. Un mot maudit, plutôt, toujours image d’une caricature. L’homme politique français a pu faire du féminisme sans le dire, grâce à la parité. Et s’il a fait de la parité un dossier politique, c’est à cause de l’Europe, à cause de la médiocrité française en matière de représentation politique des femmes, avant-dernier pays européen, juste devant la Grèce. Le ridicule tue, en France, cela est bien connu. Le dossier "parité" conjuguait donc l’urgence de résoudre un problème et l’opportunité d’un langage renouvelé pour le faire.
Ainsi débuta la controverse interne au mot parité lui-même : était-ce un nouveau principe, qui, par-delà l’égalité, apporterait un complément nécessaire à un principe fondateur de la république ? Ou n’était-ce qu’un mot, habile à promouvoir l’égalité ? Le sous-titre du livre pionnier "Au pouvoir citoyennes" était clair en modifiant les substantifs de la république : "liberté, égalité, parité" signifiait clairement que la fraternité devait céder la place à la parité. Au-delà de l’égalité, la parité serait le substantif correcteur de la fraternité ; la fraternité, en effet, étant à prendre au pied de la lettre, version masculine de la communauté, république des frères sans les soeurs. Principe correcteur de la fraternité, ou principe substitutif de l’égalité ? Le débat commençait, et ne pouvait faire l’économie d’une interrogation préliminaire sur le concept : on pouvait dire oui au mot de parité sans y voir un principe nouveau. Peut-on ajouter quoi que ce soit à la déclaration, l’espoir et l’exigence contenus dans le principe égalité ? Non, ce principe se suffit à lui-même.
Si la parité n’est pas un nouveau principe, alors c’est un mot plus qu’un concept, c’est un outil pour fabriquer de l’égalité. Si c’est un instrument, il est aisé alors de comprendre qu’il vise à la fois l’accès au partage du pouvoir politique, et toute situation de pouvoir masculin dans et hors du politique. Il s’est avéré que cet outil était le bon, et servait de révélateur à cette inégalité ultime, finale dans la bataille féministe, celle du pouvoir. Et en critiquant le pouvoir masculin, c’était bien évidemment toutes les inégalités qui s’engouffraient dans cette brèche. Ainsi revint le mouvement féministe dans toute sa force. La parité était un objectif autant qu’un outil, une fin autant qu’un moyen. Pour autant, l’enjeu philosophique restait entier.
A mes yeux, la situation se résumait ainsi : la parité est vraie en pratique et fausse en théorie. J’inversais la fameuse formule kantienne qui énonce que le vrai en théorie peut être faux en pratique. Je voulais désigner ainsi la nécessaire distinction entre la valeur d’outil de la parité et la difficulté conceptuelle de ce mot nouveau. En clair, il paraissait impossible de fonder philosophiquement la parité. Pas plus que la parité n’était un nouveau principe de la république, elle ne pouvait prendre valeur de concept démontrable. On ne fonde pas le politique sur le biologique, ni même sur le fait de nature de la différence des sexes.
La parité n’est pas un nouveau principe de la république ; elle n’est aucunement une alternative à la fraternité, pas plus qu’un complément à l’égalité. Elle se décline plutôt par des adjectifs, parité politique, parité linguistique, parité domestique. Le substantif vaut donc pour ses adjectifs. Pourquoi parler de ces adjectifs là précisément ? Parce qu’ils indiquent les lieux où le pouvoir masculin est aujourd’hui mis en cause. Tout le monde sait que le débat sur la féminisation des noms de métier est contemporain des débuts du gouvernement de 1997 où les femmes ministres font nombre, et à des postes ministériels d’importance (emploi, justice..). Tout le monde sait aussi que la confusion possible entre la cuisinière comme appareil domestique et la cuisinière comme être humain n’a jamais troublé personne (le cadre de tableau et le cadre supérieur non plus). Ainsi, c’est bien dans les lieux de pouvoir que l’emploi du féminin fait pour certains problème ; la "préfète", par exemple, épouse ou fonctionnaire, c’est selon. Et cela inquiète. Parler de parité linguistique, c’est donc pointer l’enjeu du pouvoir dans la langue. Le pouvoir peut-il apparaître dans sa sexuation ? D’aucuns pensent qu’il doit rester neutre, au neutre.
Avancer l’expression de parité domestique va dans le même sens : si la parité est un outil pour fabriquer plus d’égalité en même temps que la clé pour conquérir le partage des lieux de pouvoir, on peut dire que la famille est un espace de prédilection pour construire l’égalité et équilibrer les pouvoirs. Le couple est un microcosme de l’égalité possible et une relation où le rapport amoureux, dans sa version familiale, est un rapport de pouvoir.
L’espace économique et professionnel, en revanche, ne se prête au qualificatif de la parité que si on parle de hiérarchie et direction. Il est inadéquat de dire "parité économique" s’il s’agit simplement de désigner la question de l’égalité professionnelle, notamment salariale, ou l’inégalité d’accès à la diversité des professions. La parité ne s’applique qu’aux lieux de pouvoir. Même si le mot lui-même a permis de faire du féminisme sans le dire, a donc laissé passer à travers lui un ensemble d’aspirations multiples, comme un Cheval de Troie transportant avec lui des combats et des combattants multiples, ce mot doit toujours rester précis dans notre esprit. Il est porteur de l’égalité dans les lieux de pouvoir. L’espace économique n’est que pour partie un lieu de pouvoir. Plus encore, l’espace professionnel convoque autant le principe de l’égalité que celui de la liberté. Avant tout pour les femmes, le travail, c’est la liberté.
Les adjectifs de la parité complètent la géographie des enjeux de pouvoir ; sans épuiser pour autant la question des inégalités et des violences entre les sexes. En un mot, on peut dire que la parité politique est un enjeu de la démocratie bien plus large que la seule correction du système représentatif républicain (équilibre numérique des élus).
Deux directions s’offrent alors à la réflexion, l’une à propos du pouvoir, comme exercice, l’autre à propos de la conquête du pouvoir comme stratégie globale. Le pouvoir comme exercice appelle une réflexion propre au pouvoir lui-même. En démocratie, le pouvoir politique est identifié à la souveraineté populaire qui se donne des représentants ainsi qu’un gouvernement. Là , dans l’exercice du souverain, s’exprime la masculinité du pouvoir. Ainsi, à ceux qui disent que les militantes de la parité fondent sur la biologie (la différence des sexes) le partage du pouvoir entre hommes et femmes, il faut proposer d’inverser la réflexion en partant de la définition du souverain. En quoi l’abstraction de la souveraineté démocratique est-elle une transcendance plus sûre que la souveraineté masculine de la monarchie ? Existe-t-il vraiment une désincarnation du chef de gouvernement dans la république ? L’incarnation n-est-elle pas le lot du souverain ? Et qui dit chair, dit sexe. Ainsi plutôt que de craindre que le politique dépende de la différence des sexes, la bonne question est de se demander comment la sexuation est d’emblée inhérente au pouvoir. Question soulignée par la réforme constitutionnelle du gouvernement Jospin puisque l’article portant sur "l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions" s’inscrit à l’article 3, portant précisément sur la souveraineté. D’où le glissement a posteriori du débat politique ; l’enjeu fut au départ celui de la république et de sa représentation ; il est pour finir celui de la démocratie et du souverain. La parité n’est pas un principe nouveau mais peut-être bien un ébranlement en profondeur de la souveraineté moderne.
Le mouvement pour la parité a entraîné le mouvement féministe dans son ensemble. Il n’y a pas de raison que la mise en cause du monopole masculin ait des limites. C’est ainsi que le "vrai en pratique" de la parité peut s’entendre comme la diffusion de la critique féministe. Mais on se doit d’être plus précis : la conquête du partage du pouvoir politique est une conquête d’égalité "par le haut". Cette égalité par le haut peut-elle ne pas être élitiste ; peut-elle être l’amorce d’une égalité pour toutes ? Tel est le défi de la stratégie de la parité ; et son utopie.
Le carré de la controverse : la contradiction et l’inversion
L’impossible fondation philosophique de la parité tient à ce que la différence des sexes est appelée de l’extérieur du politique. Dès qu’on comprend qu’elle a toujours été là, le référent biologique n’est plus compris comme hétérogène au politique. Témoin le rappel des traditions historiques dans lesquelles le mouvement pour la parité a été puiser. La première tradition est celle de la réclamation universaliste des droits de l’homme, et la seconde celle de l’affirmation utopiste et révolutionnaire de l’équivalence des deux sexes. La première veut des lois qui concrétisent un principe, la deuxième imagine un monde nouveau . La parité est une utopie qui en appelle à la loi pour se réaliser. Ce croisement des deux traditions est remarquable et renvoie à la difficulté même du lien entre la démocratie et la différence des sexes.
Je terminerai en désignant les deux noeuds problématiques de ce lien, tels qu’ils apparaissent aujourd’hui, dans la pratique comme dans la théorie : le premier est celui de la catégorisation de l’universel et de la contagion des revendications ; le second est celui de l’opposition entre la sexuation du politique et l’asexuation du social.
Le premier noeud problématique a la forme d’une contradiction : d’un côté il est clair que les femmes ne sont pas une catégorie comme les autres puisqu’elles sont une moitié de l’humanité ; de l’autre il semble évident que la concrétisation de l’universel qu’elles réclament est transposable pour d’autres, la catégorie des races notamment. Il est donc tout aussi vrai de dire que la parité n’est pas une revendication identitaire d’un groupe particulier que d’envisager la "contagion" de cette même revendication par d’autres exclus. Que cela apparaisse comme une contradiction ne saurait nous faire peur.
Le deuxième noeud problématique exprime une curieuse inversion de l’inscription de la différence des sexes dans l’espace public : ces dernières décennies ont provoqué un double mouvement, l’un construisant la reconnaissance de la sexuation du politique, avec le mouvement pour la parité, l’autre fabriquant une représentaion asexuée du social (plus de mères célibataires mais des familles monoparentales, par exemple). Sexuation du politique et asexuation du social sont deux mouvements inverses et contemporains l’un de l’autre. Le XIXème siècle avait produit un discours politique au neutre et un discours social fortement sexué. Où nous mène cette inversion de la visibilité des sexes dans l’histoire politique et sociale ?
Puisque la controverse est désormais la figure de la discussion sur les sexes, il nous faut bien continuer à élaborer les problèmes à partir de l’histoire en train de se faire.
Ce texte fut prononcé à L’Université de tous les savoirs en 2000 et republié dans le recueil d’articles La Controverse des sexes, PUF, 2001.
– Table Ronde - La Parité en question

 Mots-clés :
Mots-clés :